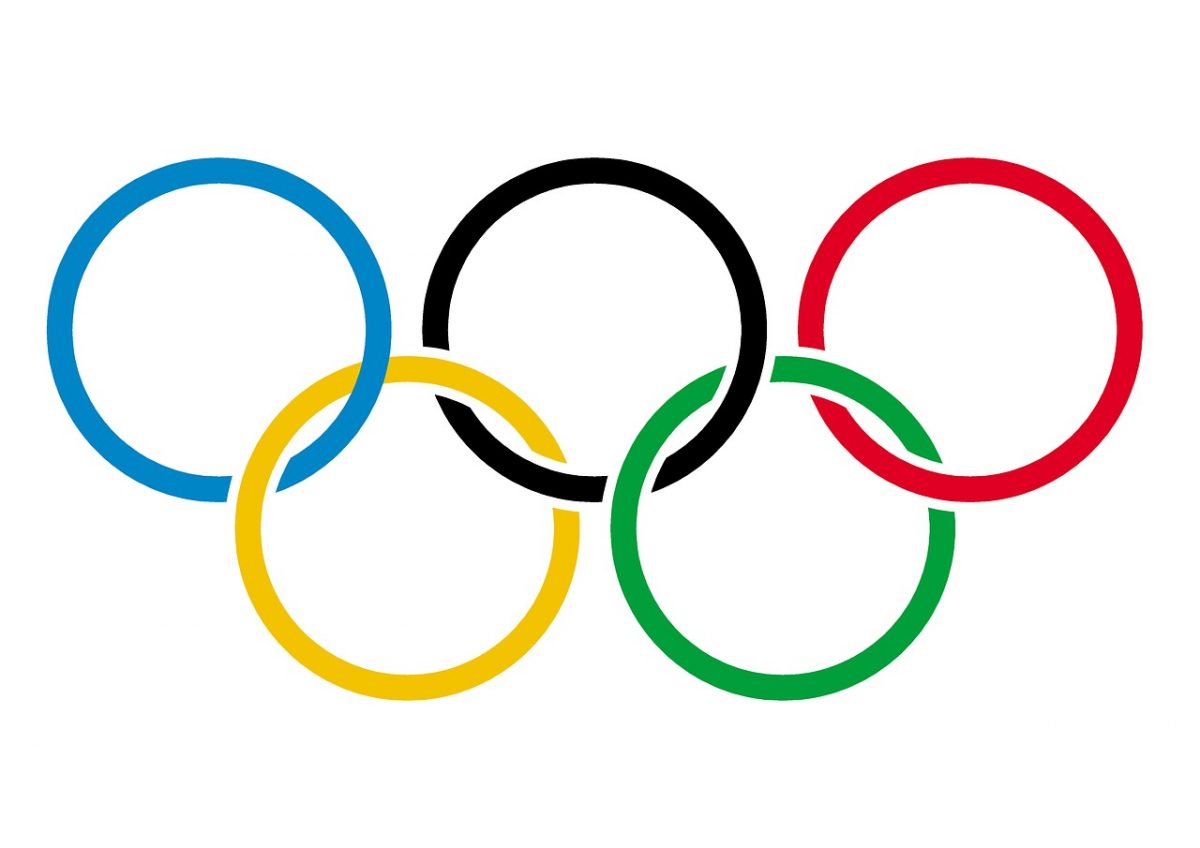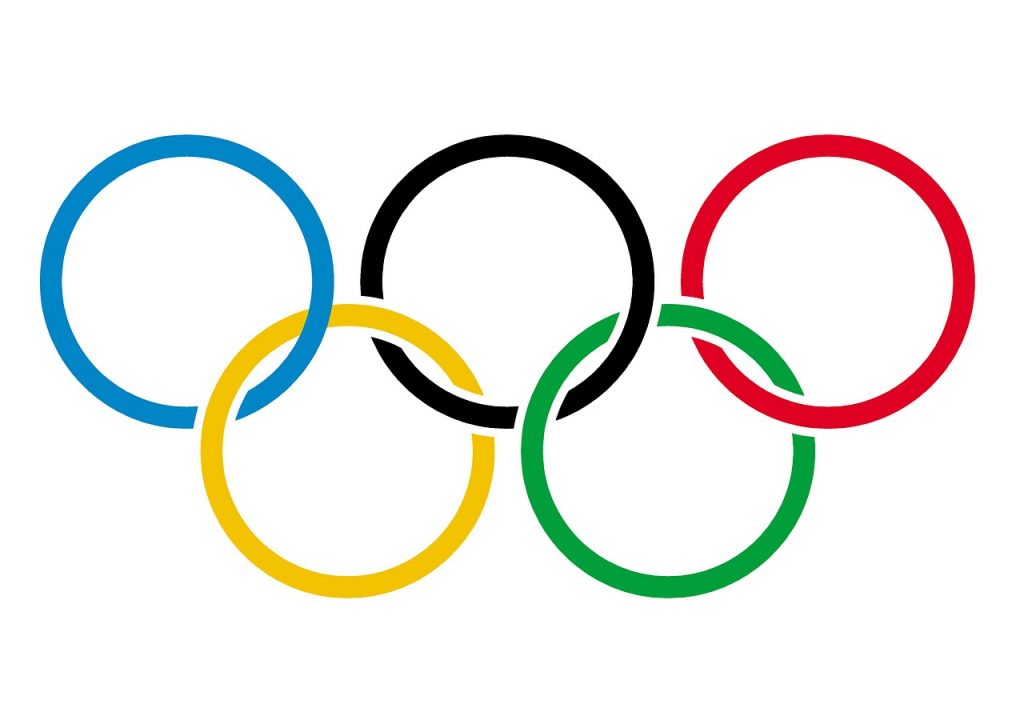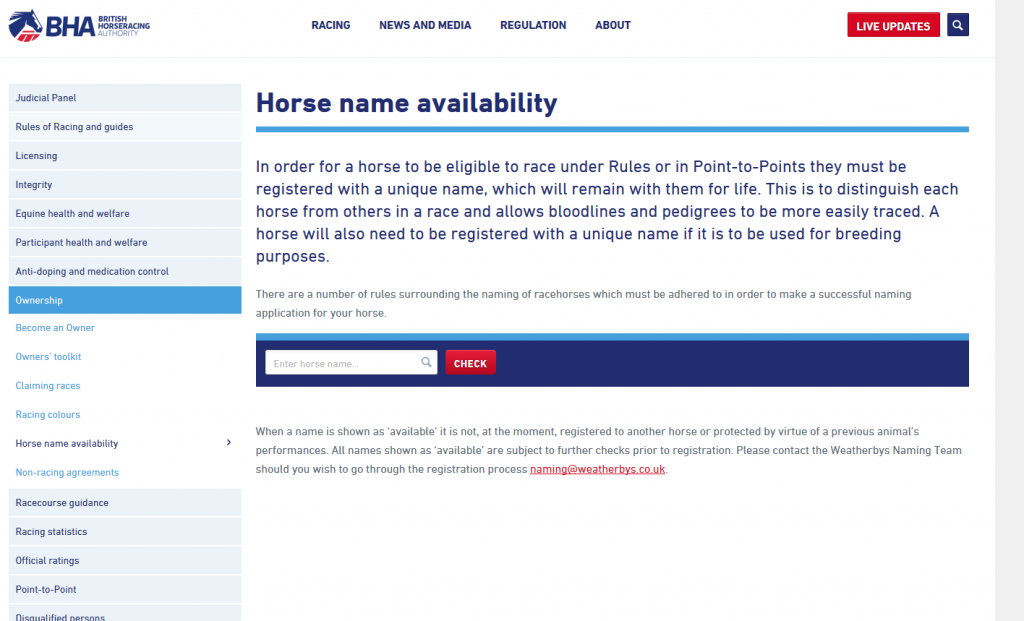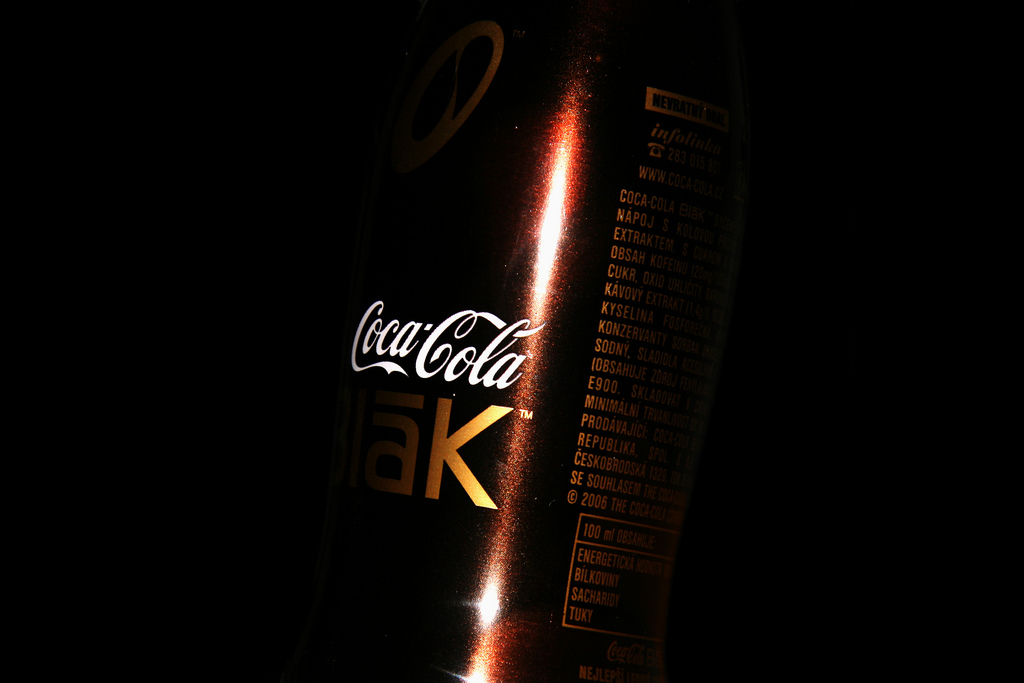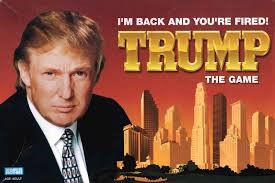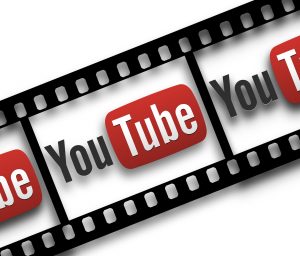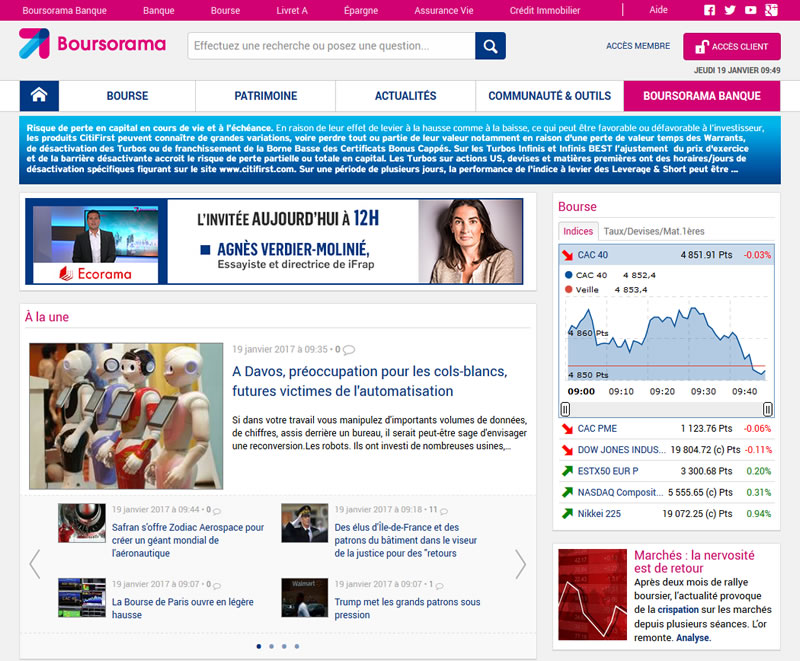Le cryptojacking, qu’est-ce que c’est ?
Le cryptojacking est une cyberattaque consistant à utiliser la puissance de l’ordinateur de sa victime afin de miner de la cryptomonnaie. Le minage de cryptomonnaie correspond à la validation d’une transaction – via l’utilisation d’un logiciel permettant de résoudre un problème mathématique qui validera cette transaction. Il s’agit d’une activité très énergivore ! Les particuliers peuvent être touchés par leurs objets connectés, et les entreprises par leur réseau d’ordinateurs.
L’attaque ne concerne donc pas les données personnelles des utilisateurs ou bien leur portefeuille. Plus concrètement, il s’agit d’installer un script de manière très simple sur une page web, en prévenant ou non l’internaute. Alors, le fichier installé exploite la puissance de calcul informatique inutilisée par l’internaute, qui peut se retrouver face à une hausse de sa facture d’électricité sans être au courant de la cause. Cybercriminels ou entreprises cherchant à générer du revenu pour supprimer la publicité, les initiateurs de ces attaques ont des profils variés et étonnants.
Pourquoi une telle augmentation de ce type d’attaque ?
Selon Symantec, le cryptojacking a représenté en 2017 environ 24% des attaques en ligne, avec une hausse de 8500% uniquement sur le dernier trimestre. L’entreprise explique tout d’abord cette explosion par une attaque beaucoup trop simple à mener. Il « suffit » en effet d’ajouter quelques lignes de code au script du site internet en question, afin de bénéficier de la puissance de l’ordinateur des visiteurs. La forte augmentation de cryptojacking en 2017 peut être aussi expliquée par la prise d’ampleur considérable des cryptomonnaies. C’est donc l’appât du gain et sa simplicité d’exécution qui justifient l’importance du cryptojacking !
Quels risques pour la victime ?
Tout le concept du cryptojacking est d’utiliser la puissance d’un ordinateur. Par conséquent, le risque de ce type d’attaque est le ralentissement de la machine touchée : les processeurs étant fortement sollicités, les opérations sur l’ordinateur sont plus lentes. Sur le long terme, les victimes peuvent assister à la surchauffe de leur batterie et donc voir leur appareil se détériorer, voire devenir inutilisable. L’intensification de l’utilisation des processeurs peut avoir de fortes répercussions sur la facture d’électricité des victimes (particuliers ou entreprises).
Comment prévenir le cryptojacking ?
Tout d’abord, que ce soit pour les particuliers ou bien les entreprises, il s’agit d’être très attentif aux attaques dites par « phishing ». Elles consistent en l’envoi de mails qui reproduisent à l’identique le visuel d’une marque afin de créer la confusion et d’inciter l’internaute à cliquer sur un lien « officiel » contenu dans le mail, et ainsi d’installer un virus sur son ordinateur. Plus de 70% des attaques de cryptojacking ont été initiées par du phishing, il faut donc être vigilant !